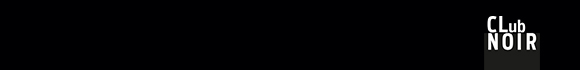
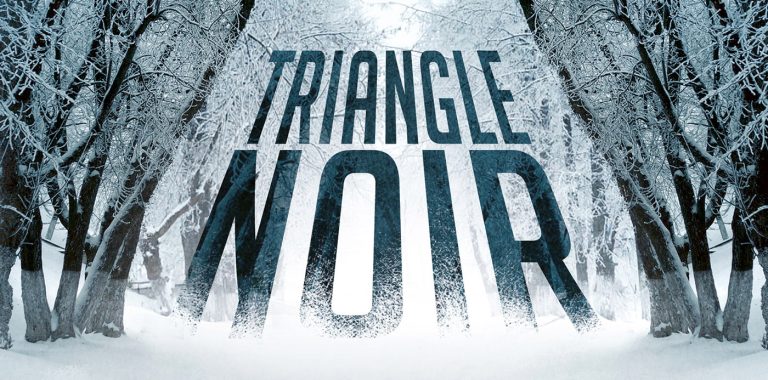
INTERVIEW EXCLUSIVE :
DÉCRYPTAGE
par Niko Tackian
Votre nouveau roman, Triangle noir, raconte une enquête sur des adolescents assassinés au milieu de la forêt des Vosges. La construction en est originale, avec une narration menée en parallèle.
En effet, on suit ici deux enquêteurs qui ne travailleront jamais ensemble pendant tout le livre. Ils vont résoudre de deux manières différentes la même histoire et se retrouver à la fin au même endroit au même moment.
D’abord il y a Max Keller, le flic, qui prend en charge le pan policier de l’enquête. Je me sens assez proche de lui, c’est un flic un peu cérébral qui mène ses enquêtes dans son coin. C’est un solitaire, quelqu’un qui a un sens aigu de la justice et surtout de l’injustice. Enfant, Max a vécu un drame puisqu’il a découvert sa mère suicidée dans sa baignoire, à un âge où un enfant n’est pas en mesure de comprendre les réactions des adultes, encore moins un suicide. Il l’a pris pour lui, ça l’a enfermé encore plus dans sa solitude naturelle. Mais Max a transformé sa culpabilité. Devenir policier et résoudre des affaires, aider des victimes, c’est la façon qu’il a trouvée de réparer ça.
Je parle de sens de l’injustice et pas de sens de la justice, parce que s’il n’y a pas moyen de faire autrement, Max est capable d’aller sauver quelqu’un au mépris des règles. Quoi qu’il arrive il ira jusqu’au bout, même s’il doit passer par des voies qui ne sont pas vraiment légales.
Comment Max se retrouve-t-il à enquêter sur la mort de ces adolescents ?
Ce dossier aurait dû être géré par la gendarmerie, puisqu’il se passe en dehors de Strasbourg, mais comme il est assez complexe la police s’en saisit. Il faut savoir que Max suit certaines affaires de manière officieuse. Il a chez lui une liste d’enfants et d’adolescents maltraités ou disparus, et une espèce de tableau de chasse où figurent un certain nombre de salauds qu’il a le projet de faire tomber. Or un des gamins assassinés appartient à cette fameuse liste de cas qui l’obsèdent, et la cheffe de Max est au courant. Entre Max et sa cheffe il y a une grande connivence, sans doute aussi beaucoup d’affection réciproque. Elle le charge de l’affaire.
Triangle noir est un roman où, même s’ils sont complexes, les personnages sont tranchés, les méchants sont vraiment méchants…
J’ai choisi d’écrire un roman dans lequel le personnage antagoniste est un antagoniste dont on ne cherchera pas à comprendre les motivations. On cherchera à savoir qui il est, comment il procède et l’ampleur de sa folie, mais on ne cherchera pas l’empathie. Parfois c’est aussi simple que ça dans la vie, certains ne peuvent pas être rattrapés avec des excuses. Dans d’autres romans, j’ai bien aimé donner des pistes de compréhension. Là ce n’est pas le cas, on a un personnage qui voue un culte profond au Mal, et qui pour y avoir accès tue des adolescents. C’est une façon pour lui d’acquérir une forme de pouvoir. Il a recréé une pensée philosophique du Mal, en utilisant des symboles qui pour beaucoup le dépassent complètement. Dont ce fameux Triangle noir, dont je ne parle pas plus ici pour ne pas en dévoiler trop.
Vous avez donc un deuxième enquêteur d’un autre genre, un criminologue.
Oui, un autre personnage va enquêter différemment, Pierre Martignas. Pierre est un expert en criminologie auprès des tribunaux, qui était très reconnu dans son métier. Mais dans sa dernière affaire, son expertise a conduit à la mort d’une famille. Il a tout quitté, a loué un chalet dans la forêt des Vosges, avec l’idée de se consacrer à une publication professionnelle pour étouffer sa culpabilité. Après la découverte des adolescents, Pierre est engagé par une femme mystérieuse pour élucider l’affaire en utilisant des moyens qui ne sont pas ceux de la police. Des moyens technologiques liés à l’intelligence artificielle. La femme, une Américaine, a essayé résoudre l’affaire elle-même avec ces moyens mais n’a pas réussi, elle s’est donc dit qu’il fallait une intelligence complémentaire, et c’est Pierre qu’elle a choisi.
Triangle Noir a aussi l’originalité d’alterner deux décors et atmosphères…
En effet, je n’avais jamais écrit de roman où on change de lieu. En général je prends un lieu et j’y construis un huis clos en essayant d’être suffocant. Cette fois, j’ai deux endroits et deux atmosphères, la forêt des Vosges l’hiver sous la neige, et grâce à l’enquête de Pierre, la chaleur du désert californien. Deux univers en forte opposition. Je parle d’un endroit très spécifique en Californie, étrange, une sorte de honte locale. C’est la ville fantôme de Bombay Beach, installée au bord de la Salton Sea, un lieu autrefois magique maintenant pourri par la pollution, les pesticides, où sont laissés à l’abandon des milliers de homeless qui s’entassent là sans aucun service public. C’est la face cachée de la Californie, l’endroit où se termine mal le rêve américain. Quand j’ai découvert ça pendant un voyage, j’ai été très marqué, je me suis dit que c’était un lieu parfait pour une histoire de thriller.
La parution de ce dixième livre est l’occasion d’avoir une vue d’ensemble sur votre travail de romancier. Vous abordez souvent la question des racines, de la mémoire, de qui on est, pourquoi ces thèmes sont-ils aussi présents ?
L’identité, savoir d’où l’on vient et qui on est, c’est quelque chose qu’on forge tout au long de sa vie, et c’est un thème qui touche en effet quelque chose de très personnel pour moi. J’utilise mes romans comme une psychanalyse, au sens propre. J’y mets les choses sensibles de ma psyché qui ont été traitées. Des éléments marquants dont je peux parler puisque je n’en souffre pas ou plus. Ça peut rester sensible, mais quand je me mets à écrire à leur propos, ce n’est plus une douleur ni une obsession.
Je pense qu’à l’origine, tout cela vient de la situation assez particulière de rupture familiale que j’ai vécue avec mon père. C’est un homme qui m’a trahi deux fois et auquel je n’adresse plus la parole depuis très longtemps. J’ai donc une relation à la confiance bafouée et à la trahison assez intense. Et j’utilise ce sentiment fort pour l’injecter dans mes personnages. Cette rupture est fondatrice dans ma personnalité et dans mon écriture.
En quoi Triangle noir entre-t-il dans ce schéma personnel ?
Triangle noir parle de violence, particulièrement infligée à des innocents, et d’espoir déçu ou pas. J’ai subi beaucoup de transformations cette année, la mort du père de ma femme, la guerre à nos portes, la maladie de ma mère, tout ça crée l’univers dans lequel j’écris et je m’en nourris. Dans Triangle noir, il y a une mère qui pourrit dans une baignoire. Ce n’était en rien conscient de ma part, mais c’est la façon dont le poids de la maladie de ma mère est réapparu dans le roman. L’écriture a pour moi ce pouvoir de mettre une distance entre les angoisses et moi, et ainsi d’une certaine manière m’en libérer.
Comment l’écriture est-elle apparue dans votre vie ?
Ça peut paraître étrange, mais ce qui m’a sauvé, très jeune, ce sont les jeux de rôle. On ne le diagnostiquait pas à l’époque, mais j’étais dyslexique. Ce sont mes enfants, dyslexiques eux aussi, qui m’en ont fait prendre conscience. Depuis toujours j’étais nul en français, vraiment nul. Les mots me paraissaient bizarres, je mettais des accents partout, j’avais des difficultés de lecture. On disait : « Il ne fait aucun effort, il n’a qu’à se concentrer. » Bref, quand j’étais au collège, dans les années quatre-vingt, le jeu de rôle a débarqué et mes copains m’ont désigné comme maître de jeu. J’ai donc acheté Donjons et dragons, et là je me suis rendu compte que c’était un pavé de deux cents pages, très aride. Mais j’ai fait l’effort de le lire. À la fin du pavé, il y avait l’annexe B, devenue mythique aujourd’hui, qui réunit toutes les références littéraires du jeu. C’est une liste de vingt-cinq ou trente livres. Comme je voulais faire les choses bien, j’ai commencé à puiser dans cette annexe B. Par ce biais j’ai lu Tolkien, Asimov, etc. que je n’aurais jamais abordés autrement. Et il s’est produit ce que tout le monde sait aujourd’hui avec la dyslexie, plus je lisais, plus il m’était facile de lire et ça s’est enclenché comme ça.
Par ailleurs, comme les jeux de rôle consistent à créer des parties, écrire des scénarios, ça a débloqué quelque chose en moi. Aujourd’hui pour moi c’est une évidence, tout est lié au fait de raconter une histoire. Je me suis emparé du rôle de narrateur.
Comment êtes-vous passé de la fiction « distraction » de l’adolescence à l’écriture en tant que métier ?
De manière ironique, par l’intermédiaire de mon père. À 20 ans, j’étais en licence de droit, je m’ennuyais terriblement. Mon père, que je ne voyais presque plus, trois fois par an dans un café, m’a proposé de venir travailler dans son groupe de presse. Avant de me donner un job, il m’a fait tourner dans tous les métiers. J’ai donc eu la chance, et je peux lui rendre ça, de faire un passage en photogravure, en distribution, en maquette, en service technique, à la rédaction… Je suis devenu pigiste, et tout s’est enchaîné, j’ai écrit des BD, une trentaine, puis des scénarios télé. Un jour on m’a proposé d’écrire une série adaptée d’un livre de Richard Hugo. Mais je ne voulais pas écrire de série tout seul, c’était trop lourd, aussi j’ai appelé Franck Thilliez, avec qui je m’entendais bien même si on n’avait jamais travaillé ensemble. Alex Hugo a commencé comme ça. Au bout de deux ans, alors que je ne cessais de proposer des idées à Franck, il m’a dit : « Pourquoi tu n’écris pas des romans plutôt ? Ces histoires il va falloir dix ans pour les développer, alors que tu pourrais les écrire. ». Je l’ai écouté et j’ai écrit ma première histoire, qui est devenue Quelque part avant l’enfer.
Comment différenciez-vous l’écriture du scénario et celle du roman ?
Elles n’ont rien à voir. Même la manière de penser ce que je vais écrire n’est pas la même. Dans un cas, l’audiovisuel, l’impulsion vient de l’extérieur, ce sont des gens qui me disent « Travaille là-dessus ». Le roman, c’est l’inverse. Il y a une volonté intérieure de raconter quelque chose. C’est pourquoi tous les scénaristes n’arrivent pas à écrire des livres, il faut pouvoir inverser le canal.
Ensuite, une fois identifiée la volonté de raconter quelque chose, il reste à trouver un ressort psychologique propre à chaque auteur et à chaque livre. Qu’est-ce qui va justifier que pendant huit mois, tous les matins je me lève en étant persuadé de devoir écrire ça ? Le roman, c’est une sorte de marathon, la dimension de lutte contre soi-même est essentielle. Personnellement, ça me conduit à des choix drastiques d’histoire bien en amont du moment où je les écris, c’est-à-dire que je mets une espèce de gravité dans le choix de mon prochain roman. Cette dimension-là n’existe pas dans les autres types d’écriture.
Aujourd’hui, quand vous regardez votre très beau parcours, qu’est-ce qui vous rend fier ?
Quand j’arrive dans une école et que je dis que je suis dyslexique, que j’ai eu 3 en français au bac et que je suis romancier, je vois s’éclairer les yeux des enfants qui ont des difficultés. Et je trouve ça formidable. À leur âge on peut croire qu’on n’y arrivera jamais, parce qu’on vous a toujours dit que raconter une histoire passe par l’écrit, mais je leur explique que dans mon cas, l’écrit a été travaillé ensuite, il n’est pas le moteur principal, le moteur principal, c’est ce que j’ai à raconter. J’aime raconter des histoires pour que les lecteurs soient pris dedans jusqu’à la fin. Si je poursuis l’analogie de la musique, je n’ai pas fait le Conservatoire, mais je sais jouer un morceau qui fait danser les gens.
Retrouvez tous les thrillers de Niko Tackian
En vous inscrivant, vous consentez à ce que Calmann-Lévy traite vos données à caractère personnel en vue de gérer votre participation au Jeu Blue Sky. Vos données sont destinées à Calmann-Lévy, aux partenaires et/ou prestataires techniques assurant la mise à disposition des dotations et aux éventuels partenaires autorisés et conservées en fonction de leur nature pour une durée conforme aux exigences légales.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, définir des directives post-mortem par mail à commercial@calmann-levy.fr et vous adresser à l’autorité de contrôle. Pour en savoir plus, consulter le Règlement du jeu-concours.